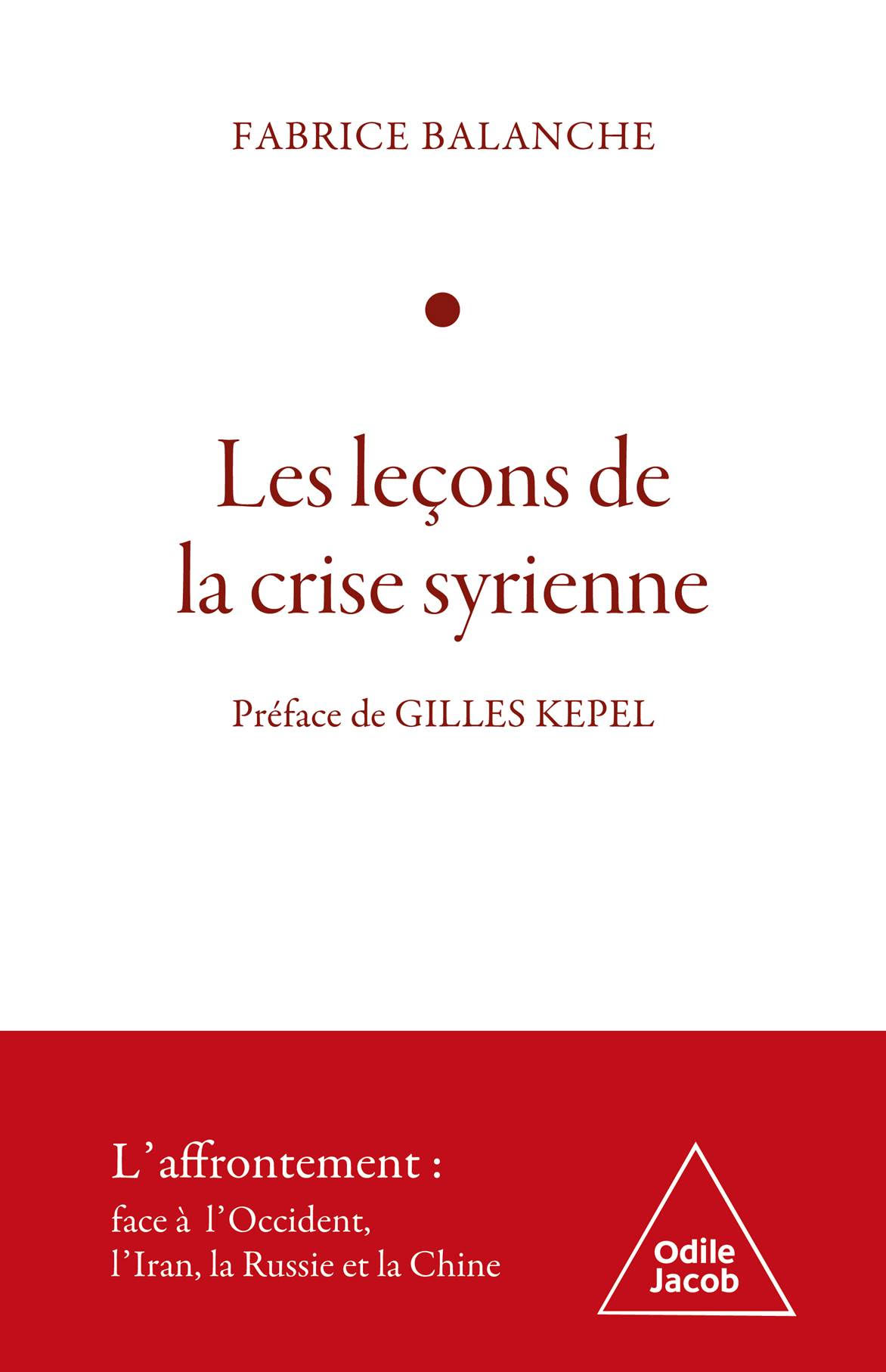Le grand entretien de France – Arménie (avril 2024, numéro 517) : géographe spécialiste du Moyen-Orient et enseignant à Lyon II, Fabrice Balanche publie un livre magistral sur le conflit syrien (Les leçons de la crise syrienne, Paris, Odile Jacob, 2024) dans lequel il expose en détails l’aveuglement occidental et nous donne à réfléchir sur les leçons à tirer de ce conflit dont nous payons encore le prix.
Entretien réalisé par Tigrane Yégavian
France Arménie : Quelles leçons principales faut-il tirer de ce conflit ?
Fabrice Balanche : Dans le livre, je tire quantités de leçons de ce conflit sur le nouvel affrontement entre l’Occident et l’axe eurasiatique, l’impact du réchauffement climatique, l’immigration comme arme de guerre, les dysfonctionnements dans l’analyse et le processus de décision en France, etc. Le fait que notre diplomatie, le monde de la recherche et nombre d’experts se soient complètement trompés annonçant la chute inévitable du régime syrien et le triomphe d’une opposition laïque et démocratique doit nous interroger sur notre vision du monde. Je ne citerai ici que trois leçons majeures :
La première est que les pays occidentaux, dont la France, doivent s’abstenir de jouer aux apprentis sorciers, c’est-à-dire éviter les interventions extérieures, si notre sécurité n’est pas directement menacée. Il est indispensable de conserver des États stables, malgré tous les défauts qu’ils peuvent avoir, pour prévenir des situations chaotiques. Vouloir apporter la démocratie est un geste généreux, mais cela exige des moyens colossaux et une volonté à long terme que nous ne possédons pas, comme le prouve l’exemple syrien.
Par ailleurs, il faut se rendre à l’évidence que la société n’était pas prête pour cette transition libérale. Les manifestants de la place Arnous à Damas, le 31 janvier 2011, avec leurs bougies et leurs pancartes, “Oui à la liberté”, demeuraient très minoritaires par rapport à ceux qui défilaient aux cris de “Allah Akbar”. La radicalisation de la contestation ne provenait pas exclusivement de la répression du régime. Elle reposait sur une réalité sociale préexistante.
La seconde leçon découle de cette conclusion : éviter de plaquer une vision occidentale sur le Moyen-Orient. La révolte en Syrie n’avait rien à voir avec la Révolution française, ni le printemps des peuples de 1848 où la contestation de l’empire soviétique en Europe, sauf dans sa partie balkanique, puisque la guerre dans l’ex-Yougoslavie a été comparable à ce qui se déroule en Syrie. Nous étions avant tout dans une guerre communautaire où le politique s’effaçait derrière les tribus, l’ethnie, la religion et les asabyya [Ndlr : cohésion sociale en tant que dynamique de solidarité qui met l’accent sur l’unité entre les individus et la conscience groupale] de quartier. Mais pour comprendre cela, il aurait fallu avoir une connaissance réaliste du terrain au lieu de plaquer des fantasmes germanopratins sur ce conflit.
La troisième leçon est qu’il ne faut jamais se laisser emporter par l’enthousiasme communicatif des opposants syriens, mais aussi iraniens, égyptiens ou biélorusses en exil : une révolution ne réussit pas forcément. Nos dirigeants, en particulier Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères à l’époque, auraient dû analyser les différentes options au lieu d’annoncer la victoire inévitable du « bien » sur le « mal ». Or, la plupart d’entre eux ont fait preuve d’une absence totale de discernement et d’objectivité dans la crise. La perte d’influence croissante de la France dans le conflit syrien, et dans le monde en général, constitue une première explication à ce manque de lucidité. Les décideurs pouvaient élaborer des stratégies hors-sols qui n’entraînaient aucune conséquence sur le terrain, puisque nous n’avions plus de poids. La seconde explication est que, même si les conditions géopolitiques changent, les décisionnaires demeurent en place et avec eux le logiciel d’analyse pour lequel ils ont été formés. En France, seules quelques dizaines de responsables sont concernés par l’alternance politique. Le logiciel d’interprétation du monde hérité de la période d’hégémonie occidentale dans lequel nous avions une place de choix se maintient grâce à l’inertie bureaucratique dans notre pays.
Quelles ont été les principales erreurs d’analyse commises par les Occidentaux lors de la guerre civile en Syrie ?
Sur le plan intérieur, les Occidentaux n’ont pas pris en compte le communautarisme qui structure la société et le pouvoir syrien. Ils pensaient naïvement que nous étions dans un schéma à « la tunisienne » comme leur expliquaient l’opposition syrienne et les chercheurs convoqués au Quai d’Orsay pour conforter les diplomates dans leurs certitudes printanières. Ils n’avaient pas compris que pour les Alaouites le conflit était existentiel. En cas de défaite du régime, ils auraient le choix entre la valise et le cercueil. Quant aux autres minorités, leur sort n’aurait pas été très enviable non plus. La France a été particulièrement myope à ce sujet, comme en témoigne la déclaration d’Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, le 28 février 2012 :
“J’appelle de mes vœux une participation des chrétiens, comme de toutes les autres communautés, à la création d’une Syrie nouvelle et démocratique où tous les citoyens auront les mêmes droits et les mêmes devoirs. Qui peut croire que les droits des minorités sont mieux protégés par des dictatures sanguinaires que par des régimes démocratiques ?” (1).
Ensuite, l’Occident a sous-estimé le caractère islamiste de la révolte, comme je l’ai expliqué précédemment. L’islamisme était profondément ancré dans la société syrienne avant la guerre. N’oublions pas que les Frères musulmans lancèrent une insurrection entre 1979 et 1982. On rêvait à Paris d’une révolution laïque et démocratique alors que le soulèvement était sous l’emprise des islamistes dès l’été 2012 et que les jihadistes d’Al-Qaïda venus d’Irak, prospéraient depuis plus d’un an. La croyance dans une chute rapide du régime qui permettrait de faire barrage aux radicaux conduisit le gouvernement de François Hollande à nier farouchement la réalité. Après la proclamation du Khalifat, en juin 2014, il s’enferma dans le dogme de la responsabilité « assadienne » pour justifier sa non-intervention contre Daech en Syrie, jusqu’à l’attentat du Thalys en août 2015. Les œillères idéologiques de l’équipe chargée du dossier syrien, sur lequel Laurent Fabius exerçait un contrôle direct, ont mis longtemps à tomber.
Au niveau international, Paris et Washington ne pensaient pas que l’Iran et la Russie soutiendraient le régime. Ils n’avaient pas pris au sérieux la stratégie de l’axe iranien au Levant, le fameux « Croissant chiite », ni la volonté impérialiste de Poutine de reconstruire l’empire soviétique. Une alliance durable entre l’Iran et la Russie leur paraissait improbable. Les diplomates s’efforçaient de traquer dans les discours de Moscou et de Téhéran des signes de divergence qui permettaient d’étayer leur thèse. Et puis la Russie n’avait, selon eux, pas les moyens de soutenir un régime à bout de souffle. Experts et journalistes rejoignaient les conclusions du Quai d’Orsay par suivisme et carriérisme. Ainsi le quotidien Le Monde titrait le 2 juin 2015 : « Moscou prend ses distances avec Damas » (2). Quatre mois plus tard, la Russie intervenait directement en Syrie. Là, les Américains furent les plus dubitatifs quant au succès de l’opération : “Une tentative de la Russie et l’Iran de soutenir Assad et d’essayer de pacifier la population qui va juste les bloquer dans un bourbier et cela ne fonctionnera pas”, selon le président Barack Obama, le 3 octobre 2015. L’Occident n’avait pas compris que l’axe eurasiatique naissant (Russie, Iran et Chine) utilisait la Syrie pour mettre fin à leur hégémonie d’un quart de siècle sur le monde depuis la chute de l’URSS.
En quoi ce conflit marque-t-il un tournant dans les relations internationales et des relations nord-sud en particulier ?
En 2012, le ministre des Affaires étrangères syrien, Walid Moualem, disait : “C’est terminé, nous ne regardons plus vers l’Europe, mais vers l’Est”. Il sous-entendait la Russie et l’Iran pour leur soutien militaire et la Chine pour sa puissance économique. À cette époque, l’Union européenne (UE) prenait chaque mois de nouvelles sanctions. En 2018, les États-Unis ont établi avec le Caesar Act un blocus contre le régime. Cependant, il n’est pas dans la situation de celui de Saddam Hussein, entre 1991 et 2003, lorsque lui aussi a été placé sous embargo. La parenthèse d’hégémonie occidentale qui s’était ouverte avec l’effondrement de l’URSS (1989-1991) s’est refermée avec la crise syrienne. Désormais, un axe eurasiatique, dominé par la Chine et la Russie, tente de faire jeu égal avec l’Occident avant de parvenir à le dépasser dans le futur. Les États convoités du Sud, la nouvelle appellation de Tiers-Monde, font jouer la concurrence entre les deux « blocs » comme au temps de la guerre froide. Le Kremlin peut leur fournir de l’armement et des supplétifs pour remplacer les troupes occidentales. L’exemple du Mali, où la junte militaire a substitué la milice russe Wagner aux forces françaises en 2022, est des plus éloquents. Qu’importe si la France suspend son aide au développement à ce pays du Sahel : il peut se tourner vers d’autres bailleurs de fonds, comme la Chine, désireuse de s’implanter en Afrique (3). Le Burkina Faso et le Niger ont suivi le mouvement. La puissance économique chinoise offre l’opportunité de s’affranchir de l’Occident pour l’accès à la technologie et aux financements. Par ailleurs, elle n’oppose aucune condition concernant le respect des droits de l’Homme et le progrès vers la démocratie à l’octroi de prêts. La guerre en Ukraine a mis en évidence la place stratégique de Moscou sur le marché mondial des céréales, ce qui contribue à neutraliser beaucoup de pays qui auraient pu condamner à l’ONU l’agression de son voisin. C’est notamment le cas de l’Égypte, dépendante à 61% de la Russie et à 23% de l’Ukraine pour son alimentation en céréales (4). Dans son ouvrage, L’affolement du monde, Thomas Gomart affirme que “le monde change, mais que les Européens ne veulent pas le voir changer.” (5)
Au Moyen-Orient, même nos alliés les plus proches, tels que le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, rééquilibrent leurs relations au profit de l’axe eurasiatique. La situation de l’UE se révèle particulièrement schizophrénique. Comment demander au Qatar de livrer plus de gaz, tandis qu’au Parlement européen des voix s’élèvent pour dénoncer le non-respect des droits de l’Homme et exiger le boycott de la coupe du monde de football. Les pays occidentaux s’opposent à l’invasion de l’Ukraine et apportent leur soutien économique et militaire à Kiev. En revanche, ils restent passifs face à l’agression de l’Arménie par l’Azerbaïdjan et la Turquie. L’UE a besoin du gaz azéri qui transite par la Turquie. Cette dernière dispose en outre de l’arme des migrants si l’UE décidait de prendre des sanctions à son égard.
Doit-on sacrifier les droits de l’Homme sur l’autel de la realpolitik ? Dans ce monde multipolaire en violente compétition, depuis la fin d’une parenthèse d’hégémonie occidentale d’un quart de siècle, il est devenu difficile d’intégrer les critères éthiques dans nos relations politiques, car nous courons le risque de perdre nos alliés au profit de l’axe eurasiatique. Cela ne signifie pas qu’il faille tout pardonner aux despotes, mais il faut être conscient des limites d’une diplomatie de la morale.
La reconstruction de la Syrie est empêchée par les sanctions internationales qui rappellent le martyre du peuple irakien sous embargo dans les années 1990. Comment envisager l’avenir ?
Les sanctions existent, mais elles ne sont pas comparables à l’embargo occidental sur l’Irak entre 1990 et 2003 qui a effectivement plongé la population irakienne dans une situation désastreuse. D’une part, le Caesar Act ne touche pas les produits alimentaires. D’autre part, le nouveau contexte international fait que la Syrie n’est pas isolée comme l’Irak de Saddam Hussein. La Russie, l’Iran, la Chine, l’Inde et bien d’autres pays continuent de commercer avec la Syrie en dépit des sanctions ou en les contournant. Certes, les sanctions empêchent les investissements occidentaux et les entrepreneurs syriens, qui sont à l’étranger, d’investir dans leur pays, car leurs activités à l’extérieur seraient touchées, comme l’explique très bien Pauline Khoury, dans sa thèse sur les hommes d’affaires syriens à l’étranger. Mais le blocage principal provient de l’absence de paix en Syrie. Le pays est toujours divisé et la situation dans le Nord-Ouest, autour d’Alep, n’est pas stable, empêchant cette grande métropole industrielle de redémarrer. Il faut ajouter une intense corruption et un racket qui détournent les entrepreneurs des activités productrices. Seul l’immobilier connaît une certaine prospérité, en raison de la demande et de la capacité de ce secteur à recycler les capitaux issus de l’économie de guerre. La Syrie ne reçoit pas d’aide à la reconstruction, y compris les zones tenues par l’opposition. Pour l’Union européenne, ce mot est tabou tant que la résolution 2254 des Nations unies (transition politique et élections libres) ne sera pas appliquée. Elle se contente donc d’une aide humanitaire d’urgence pour subvenir aux besoins de base de la population : nourriture, eau et santé. Cependant, il n’est pas question de financer la remise en route des systèmes productifs et la reconstruction des infrastructures de communication, les réseaux d’eau et d’égout. Ainsi à Hassakeh, ville privée d’eau depuis que la Turquie contrôle la source Allouk, qui alimentait cette ville d’un demi-million d’habitants aujourd’hui, l’Union européenne finance du transport d’eau par camion au lieu de construire une nouvelle canalisation.
Les pays alliés de la Syrie ne sont pas généreux. L’Iran finance une aide alimentaire et énergétique, en envoyant régulièrement des pétroliers à Banias, mais c’est assez basique. Quant à la Russie, il n’est plus question, comme au temps de l’URSS, d’apporter à fonds perdu des financements à un pays « frère ». Bien au contraire, elle exige d’être payée en retour de son soutien militaire. Elle a ainsi obtenu l’exploitation du pétrole, du gaz et du phosphate ainsi que la concession du port de Tartous. Régulièrement, Bachar al-Assad doit réunir des centaines de millions de dollars pour payer les traites que lui présente Moscou, sans quoi son armée se voit privée de munitions. Le régime fondait de grands espoirs vis-à-vis de Pékin, persuadé que le Bilad al-Cham [Ndlr : nom donné par les conquérants arabes au Moyen Âge à la Grande Syrie, soit les États actuels de Syrie, Liban, Jordanie et Palestine, plus une partie du sud-est de l’actuelle Turquie] allait retrouver sa place ancestrale sur les routes de la soie et devenir une grande zone industrielle chinoise. Mais la désillusion fut cruelle : la Syrie n’intéresse pas la Chine, car elle est sans ressource, trop petite et instable. Enfin, Bachar al-Assad espère un soutien des pays arabes du Golfe depuis qu’il a été réintégré dans la Ligue arabe, mais là encore les milliards de pétrodollars ne se déverseront pas sur la Syrie.
L’avenir du pays est donc bien sombre et les jeunes quittent le pays en masse, c’est une condition de survie pour eux et leur famille. Désormais, plus de huit millions de Syriens vivent à l’étranger, soit 30% de la population. L’argent qu’ils transfèrent à leurs proches restés au pays est indispensable pour leur éviter de sombrer dans la misère.
Un débordement du conflit de Gaza en Syrie est-il une hypothèse réaliste ?
Conserver le diable que l’on connaît ou bien se risquer vers l’inconnu ? Voilà comment nous pouvons résumer le dilemme israélien vis-à-vis de la crise syrienne. Durant les deux premières années, de mars 2011 à mai 2013, date des premières frappes sur des cibles iraniennes à Damas, Israël s’est tenu prudemment à l’écart du conflit, tout comme de l’ensemble du Printemps arabe, du reste. Ensuite, Tsahal s’est contenté de frapper les objectifs pro-iraniens qui étaient dirigés contre l’État hébreu, notamment les transferts de missiles au profit du Hezbollah. Depuis le massacre du 7 octobre 2023, on remarque une inflexion de la position israélienne à l’égard du régime syrien. Désormais, l’État hébreu possède une plus grande détermination et une plus grande volonté de prendre des risques à l’égard du Hezbollah, de l’Iran et de Bachar al-Assad si nécessaire. Dès le début de la guerre à Gaza, la chercheuse israélienne Carmit Valensi (6) rapporte qu’Israël a envoyé des messages au président syrien le mettant en garde contre une intervention syrienne dans la guerre, sans quoi, non seulement Damas serait en danger, mais lui-même. Cela constitue sans doute une meilleure explication de son absence à la COP 28 de Dubaï, que la peur du mandat d’arrêt international délivré par la France à son égard (7).
Certes, le régime, affaibli par douze années de guerre, n’a que peu d’appétence pour attaquer Israël, mais si l’Iran souhaitait se servir de son territoire pour ouvrir un nouveau front, il ne lui demanderait pas la permission. Des roquettes et des obus de mortier ont été tirés sur les hauteurs du Golan dès le début du conflit. Cependant, les efforts iraniens sont davantage tournés contre les forces américaines stationnées dans l’Est. Le but est de pousser les troupes américaines au départ. Cela aurait l’avantage de permettre le retour des régions du nord-est dans le giron de Damas. L’Iran préfère, au moment où nous écrivons ces lignes, consolider son axe terrestre plutôt que de se lancer dans une confrontation directe et hasardeuse contre l’État hébreu, mais cela ravive les craintes israéliennes quant à une future offensive militaire, une fois Téhéran en possession de l’arme atomique. Donc, un débordement du conflit est possible en Syrie, mais je pense qu’il se produira au Liban auparavant.
En 2012-2014, vous aviez été la cible d’un lynchage de la part d’une partie de l’establishment médiatique et universitaire français. En cause, vos analyses sur la Syrie. Aujourd’hui, force est de constater que vous aviez eu le tort d’avoir raison trop tôt…Quelles leçons personnelles en avez-vous tirées ?
Tout d’abord, ce n’est pas parce qu’on est seul qu’on a tort, mais en termes de carrière il est préférable d’avoir tort avec tout le monde plutôt qu’être le seul à avoir raison. Cela dit, même en toute connaissance de cause si c’était à refaire j’agirais de la même façon, car le Franc-Comtois est connu pour son entêtement. Lors du siège de Dole (alors capitale du Comté, dépendant du Royaume d’Espagne) par les Français en 1636, le Prince de Condé, à la tête d’une impressionnante armée, aurait lancé :
– Comtois, rends-toi !
Les Francs-Comtois, assiégés, auraient alors répondu : – Nenni, ma foi !
Avec de tels ancêtres, il m’était donc impossible de céder aux diverses pressions qui se sont exercées pour que je change de discours sur la crise syrienne. Je l’ai payé très cher, puisque le laboratoire de recherche, dont j’étais le directeur, a été fermé d’autorité par le CNRS. On m’a également fabriqué une réputation d’affreux pro-Assad, afin que je n’obtienne pas de poste dans les instituts français à l’étranger, dépendant du ministère des Affaires étrangères, ni aucune promotion à l’université. Néanmoins, j’ai passé trois années dans deux think tanks américains à Washington où mes analyses sur la crise syrienne sont toujours très appréciées. Gilles Kepel a publié en 2023, un ouvrage qui s’intitule Nul n’est prophète (8), dans lequel il dénonce justement ce type de lynchage à l’égard des réalistes que nous sommes. En France, il est toujours préférable d’avoir tort avec Sartre que raison avec Aron.
(1) L’Orient le Jour, 29 février 2012.
(2) Christophe Ayad, « Moscou prend ses distances avec Damas », Le Monde, 2 juin 2015.
(3) « Le Mali et la Chine signent un accord pour l’installation de deux unités de filature », Andalou Ajensi, 26 novembre 2022. https://www.aa.com.tr/fr/ afrique/le-mali-et-la-chine-signent-un-accord-pour-l-installation-de-deux-unit%C3%A9s-de-filature/2748488
(4) « En Égypte, une dangereuse dépendance au blé de la mer Noire », Les Échos, 15 mars 2022, https:// www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/en-egypte-une-dangereuse-dependance-au-ble-de-la-mer-noire-1393794
(5) Thomas Gomart, L’affolement du monde. 10 enjeux géopolitiques, Paris, Tallandier, 2019.
(6) Carmit Valensi, « Supporteur de loin : avec tout le respect que je dois aux Palestiniens – Assad a d’autres projets en Syrie », 27 novembre 2023, Mako. https://www.mako.co.il/news-columns/2023_q4/Article-f9879696f401c81027.htm
(7) Luc Mathieu, « Syrie : Bachar al-Assad a-t-il eu peur d’être arrêté à la COP28? », Libération, 1 décembre 2023.
(8) Gilles Kepel, Nul n’est prophète, Paris, Editions de l’Observatoire, 2023.